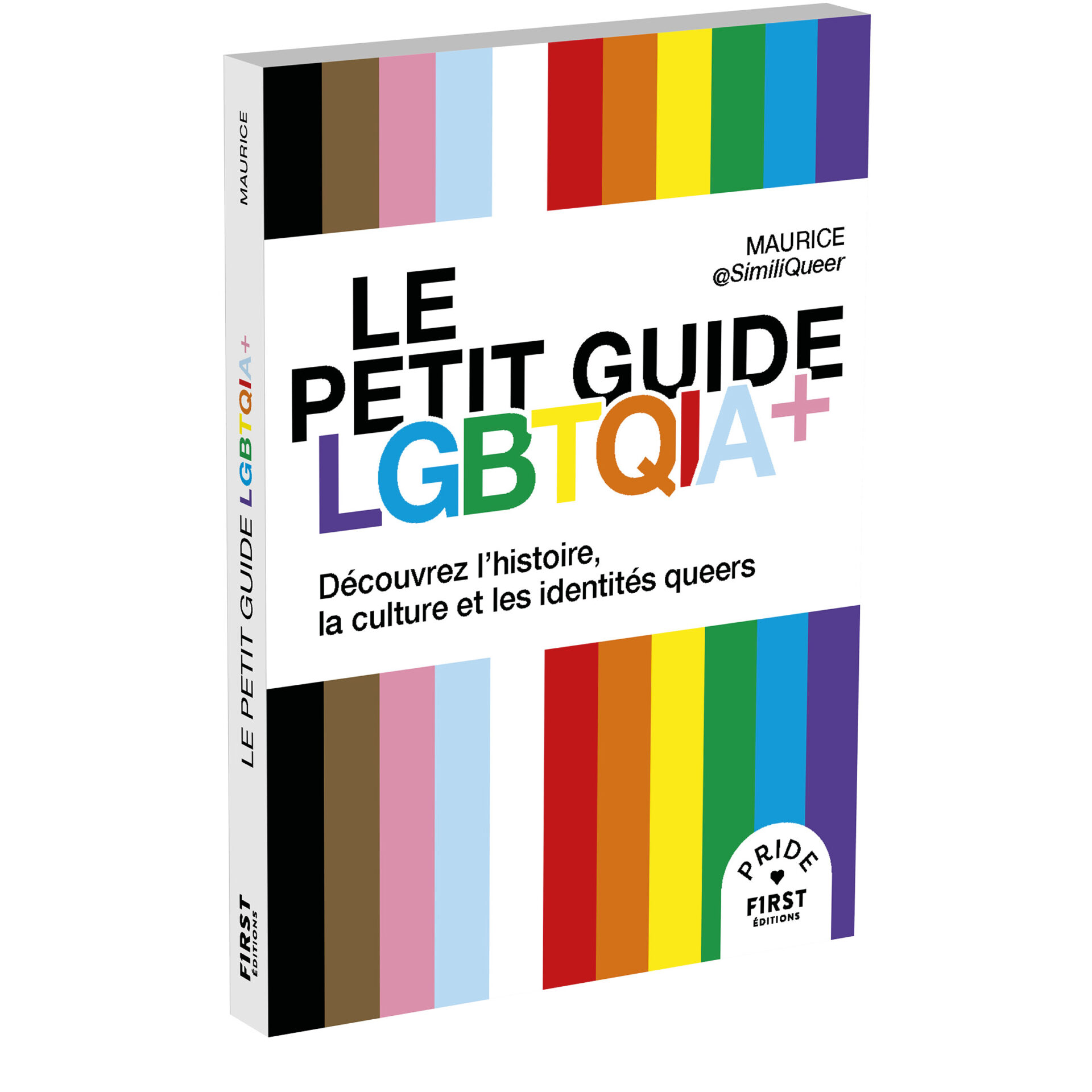Ipsos a dévoilé en juin 2025 les résultats de l’étude Global Advisor « Pride » qui cherchait à comprendre comment était perçue la communauté LGBTQ+ à travers le monde. L’enquête a été menée dans 26 pays auprès de 19 028 personnes âgées de 18 et plus sur sa plateforme en ligne Global Advisor entre le 25 avril et le 9 mai 2025. L’occasion pour Similiqueer de faire le point sur le cas français.
En France, depuis quelques années, les personnes LGBTQ+ parviennent à occuper l‘espace médiatique et public. L’objectif est simple : accroître la visibilité queer pour que la tolérance soit, à son tour, plus importante.

Cependant, être queer dans l’espace public, ce n’est jamais simple. Comment les autres me perçoivent-ils ? Est-ce que je risque de me faire agresser ? Que se passera-t-il si j’embrasse mon amoureux·se dans la rue ? Toutes ces questions légitimes sont le résultat de faits bien réels : agressions, harcèlement, voire meurtres de personnes LGBTQ+ pour le simple fait d’exister.
Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que les personnes LGBTQ+ sont bel et bien une minorité en France et représente environ 9 % de la population. Si l’on a l’impression que nous sommes de plus en plus nombreux, c’est surtout parce que les queer assument de plus en plus leur identité au lieu de rester dans le placard.
Un soutien à la communauté LGBTQ+ mitigé en France
De façon générale, par rapport aux chiffres de 2024, le sondage montre que les Français·es soutiennent moins les LGBTQ+ en 2025. Par exemple, en ce qui concerne la représentation de personnages LGBTQ+ à la télévision, dans les films ou les livres, seulement 28 % des Français·es sondés y sont favorables, soit 4 points de moins qu’en 2024. Il y a encore du chemin à parcourir à ce niveau.
D’un point de vue historique, il faut rappeller que le monde du cinéma a longtemps participé à censurer les représentations LGBTQ+ dans les films. Une censure qui n’a pas disparue aujourd’hui, mais a changé de visage.
En théorie, la moitié des Français·es disent soutenir les personnes LGBTQ+, qu’elles soient ouvertement queer, qu’elles expriment leur affection en public ou qu’elles soient dans des équipes sportives. Cependant, on remarque que si l’on s’attaque à la représentation queer en pratique, alors le soutien se fait plus rare. Moins que 4 personnes sur 10 soutiennent les entreprises ou les employeur·euses qui mettent en place des actions pour soutenir et promouvoir les identités queer.
L’approbation publique est en baisse de façon mondiale, et pas seulement en France, qui est d’autant plus inquiétant pour les queer qui pourraient cherche à déménager pour vivre dans un pays plus sécurisant. Sur ce même sujet du soutien aux entreprises et marques promouvant l’égalité pour les personnes LGBTQ+, le soutien mondial chute de 3 points par rapport à 2024.
On remarque aussi que :
- au Royaume-Uni, la chute est de 7 points ;
- aux États-Unis, on perd 1 point ;
- en France aussi, un point en moins ;
- la Pologne connaît un recul marqué de 10 points, avec plus d’opposition que de soutien, ce qui est assez rare au niveau mondial.
Soutenir les personnes LGBT+ en théorie, tolérer leur présence dans l’espace public et ne pas s’opposer à leur existence semble dans les cordes de la moitié des Français·es mais dès qu’il s’agit de mener des actions pour aider les personnes queers, notamment dans le monde professionnel la plupart s’effacent. Il ne faudrait pas prendre trop de place.
Sur ce sujet, la France se positionne à la 16ème place sur 26 pays, le dernier étant le moins engagé dans le soutien.
Un fossé générationnel et entre les genres
Tous pays confondus, on observe un vrai choc des générations, mais surtout un écart net entre les femmes et les hommes. Les femmes de la génération Z sont 58 % à soutenir les entreprises et les marques qui font la promotion de l’égalité pour les personnes LGBT+, contre 34 % des hommes.
Un chiffre qui témoigne de l’essor du masculinisme chez les jeunes générations : toutes les autres générations soutiennent plus ce fait que les hommes de la génération Z, avec les baby boomers en tête (40 %).
Des chiffres qui découlent de faits : les femmes, notamment les féministes, sont les plus engagées vis-à-vis de la communauté LGBTQ+, qu’elles soient concernées par le sujet ou non. Cela s’observe aussi bien sur les réseaux sociaux en ligne que dans la rue lors des manifestations pour les droits des femmes et des minorités.
Théorie vs. pratique : un soutien à la communauté LGBTQ+ à l’épreuve des actes
En ce qui concerne les droits et la protection des personnes queer, on remarque encore une fois qu’en théorie, une grande majorité est pour, mais que s’il s’agit d’adopter des lois permettant d’acter cette protection dans les faits, alors une partie du soutien disparaît.
On peut tout de même se réjouir : les Français figurent parmi les populations qui soutiennent le plus les législations visant à bannir les discriminations contre les LGBTQ+, l’échelle mondiale étant de 51 %.
Alors que tout le monde s’exprime sur les droits que devraient avoir les personnes LGBTQ+, peu en parlent avec les concerné·es. Moins d’une personne sur deux connaît une personne homosexuelle.
Quand il s’agit des droits des personnes transgenres, le soutien est plus inégal. 7 % des Français·es affirment connaître une personne transgenre et il s’agit de la catégorie de population qui subit le plus de discrimination parmis les LGBTQ+.
46 % des Français soutiennent l’accès aux transitions médicales pour les adolescent·es trans avec l’accord des parents, 36 % s’y opposent.

Un sujet obtient toujours un fort soutien : le mariage pour tous·tes. 67 % des Français soutiennent le mariage pour les couples de même genre de façon légale, et 12 % soutiennent une forme de reconnaissance juridique autre que le mariage.
Des positions pro-LGBTQ+ fragiles en France
Malgré le soutien de principe pour le mariage pour tous·tes, le véritable engagement de la société française envers la communauté LGBTQ+ reste fragile. Les chiffres de l’étude Global Advisor Pride d’Ipsos sont sans appel : une fois passée la théorie, la tolérance se heurte à des réticences dès qu’il s’agit d’actions concrètes.
Les personnes LGBTQ+ françaises ne peuvent pas se contenter d’un simple soutien passif. Plus que jamais, alors que la plupart des marqueurs sont à la baisse par rapport à l’année précédente, les personnes queer ont besoin d’un engagement actif pour leurs droits et leur reconnaissance. D’autant plus que les acteur·ices politiques français·es ne se cachent plus quand il s’agit d’exprimer des positions anti-LGBTQ+.
Il ne suffit pas de dire « oui » à l’existence des personnes queer, il faut s’engager activement pour leur inclusion. Qu’il s’agisse d’encourager la visibilité à l’écran ou de soutenir les entreprises qui promeuvent l’égalité, notre pays est à la traîne.
Chacun·e a son rôle a jouer, qu’il s’agisse de soutenir ses collègues queer au travail, soutenir son enfant après un coming out ou simplement condamner toute remarque LGBTQ+phobes.
Au-delà de s’intéresser aux chiffres du soutien, il faut aussi s’attaquer aux oppositions. Pour quelles raisons ces personnes peuvent-elles s’opposer aux personnes queer ? En connaissent-elles seulement ?
La visibilisation de nos vécus, la rencontre, la discussion et le partage d’expériences aident à lutter contre les stéréotypes et les réticences qui naissent de la méconnaissance et la peur. C’est d’ailleurs ce que font de nombreuses associations, à l’image de celles qui se battent pour visibiliser les vécus des seniors LGBTQ+.
Pour que la France rejoigne le peloton de tête des nations véritablement inclusives, un effort collectif est indispensable. Il est temps de passer des mots aux actes.