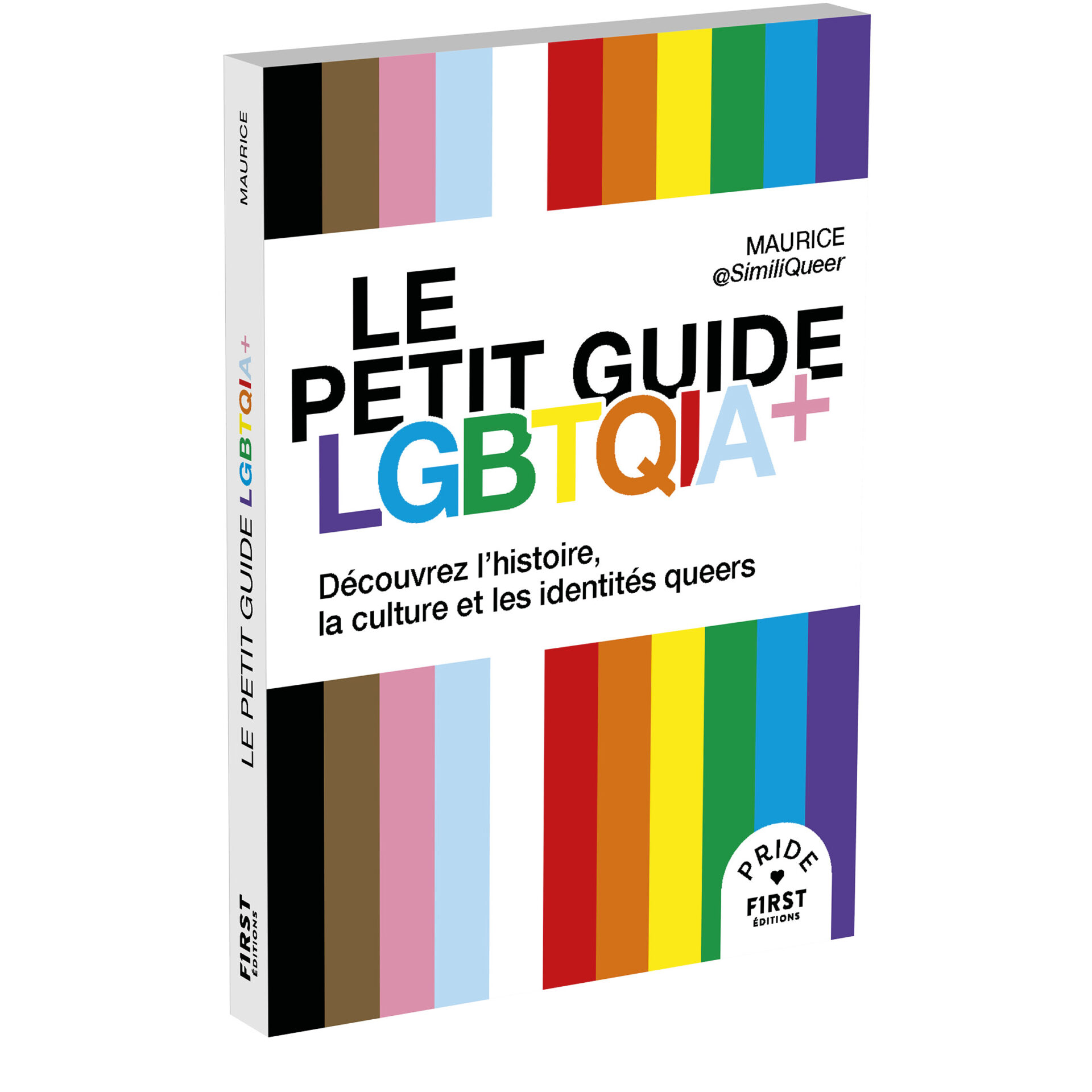Tout n’est pas binaire. Si les cultures occidentales se fondent sur les différences entre les genres masculins et féminins et organisent l’ensemble de sa société autour de la domination du premier sur le second, certaines sociétés ont opté pour un fonctionnement très différent.
Dans l’isthme du Yucatan, au sud du Mexique, et plus particulièrement dans l’État d’Oxaca, les muxes sont la preuve qu’il est possible de reconnaître un troisième genre. Leur existence daterait de bien avant l’invasion espagnole. Certains documentaires mentionnent les muxes dès le XVIe siècle.
Ancré socialement dans des sociétés aux cultures diverses et variées, le genre est un concept en constante évolution. Il est sans cesse revisité par les personnes qui le performent et transgressent les limites qu’on pense lui connaître.

À l’origine, le terme muxe vient du mot espagnol mujer, qui signifie femme. Un·e muxe est une personne assignée homme à la naissance, qui adopte les codes sociaux associés au genre féminin. Un·e muxe peut être vestidas (avoir une apparence féminine) ou pintadas (avoir une apparence masculine).
En 1970, on estime que 6 % des personnes assignées hommes des Isthmes de la communauté Zapothèque étaient muxes.
Juchitán, capitale matriarcale
Juchitán de Zaragoza est une ville du Mexique située dans l’État d’Oxaca. Sa population est majoritairement zapotèque et continue de parler la langue de cette civilisation depuis près de deux mille ans.
La société y est matriarcale. Ce sont les femmes qui dirigent les familles et lèguent leur nom aux enfants. Elles sont en tête du commerce et détiennent le pouvoir économique. Les hommes se chargent de l’agriculture et de la pêche. Ils doivent même demander à leur femme de l’argent s’ils veulent s’en servir.
À leur quinzième anniversaire, les jeunes filles de Juchitán deviennent des reinas, des reines. Dans une société dirigée par les femmes, les explorations du genre et de la sexualité ne posent pas de problème particulier.


À Juchitán, il existe bien trois genres : femme, homme et muxe.
« La plupart des muxes se concentre dans des quartiers périphériques, au sud de la ville de Juchitán, appelée abajio (en bas), où vit une population défavorisée composée notamment de paysans, pêcheurs, artisans, ouvriers et des familles qui se sont enrichies grâce au narcotrafic aux cours de ces dernières années », explique l’anthropologue Marinella Miano Borruso(1).
« Les muxes qui y habitent gèrent des cafés, des restaurants, de petits commerces, ils sont brodeurs, tailleurs, domestiques ou coiffeurs. Dans la plupart des cas, ces muxes sont des vestidas », ajoute-t-elle. Dans les quartiers plus riches, les muxes exercent des professions libérales, sont stylistes, professeur·es, emlployé·es ou commerçant·es.
L’anthropologue précise qu’il n’y a pas de formes de discriminations les uns envers les autres, mais que les personnes ont de la famille dans plusieurs quartiers de la ville, et qu’elles fréquentent et participent aux mêmes réunions.

Muxe et identités LGBTQ+
De nombreux points de la culture muxe rappellent des parcours de personnes transgenres. Notamment parce que les muxes connaissent un moment de prise de conscience de leur identité qui va à l’encontre du genre qui leur est assigné à la naissance. Toutefois, peu de muxe vont jusqu’à transitionner médicalement, puisque cela n’est pas un besoin pour eux.
Attention toutefois, nos concepts occidentaux ne suffisent pas à capter l’essence même de cette identité pensée dans la culture zapotèque.
« Ce qui nous différencie des homosexuels, des travestis ou des transgenres, c’est que nous naissons dans l’isthme de Tehuantepec, et nos premiers mots sont prononcés dans la langue de cette région où la distinction de genre n’existe pas », rappelle Elvis Guerra, muxe, poète·sse et traducteur·ice de zapotèque.
Dans le reportage « Les MUXES, un troisième genre », on rencontre un enfant, Elvis, qui affirme qu’il préfère qu’on l’appelle Carolina et qu’il a toujours su qu’il voulait être muxe.
« Je ne suis pas une femme. Je ne suis pas un homme. Je suis un·e muxe »


Cependant, il ne faut pas réduire l’identité muxe à une forme de transidentité exclusivement féminine, parce qu’il s’agit d’une construction au-delà des genres binaires masculins et féminins. Ce n’est pas un entre-deux, mais un véritable spectre où les personnes assignées hommes à la naissance peuvent naviguer en embrassant à la fois leur féminité et leur masculinité.
S’ils ont des corps perçus comme masculins, les muxes ont des compétences associées au féminin, ils sont une combinaison du féminin et du masculin ce qui les place dans une catégorie à part entière.
Certain·es muxes sont homosexuel·les, et sont en relation avec des hommes. Mais iels ne sont pas considérés comme des hommes gays. Traditionnellement, les muxes étaient chargé·es d’initier sexuellement les hommes puisque les femmes devaient rester vierge jusqu’au mariage.
Marina Miano Borruso explique cette fonction des muxes : « dans la tradition, les muxes initient les adolescents à la vie sexuelle adulte (…) et les règles de la séduction en général ».
Un récit confirmé par Félina : « les muxes ont toujours eu une vie sexuelle très active, mais jamais pour de l’argent. Dans cette ville, beaucoup d’hommes se sont dépucelés avec une muxe. Mais personne ne l’avouera jamais ».
Un homme qui relationne avec un·e muxe contre de l’argent est nommé mayate, et n’est pas nécessairement considérés comme homosexuel, puisque les muxes ne sont pas des hommes. Toutefois, les muxes occupent parfois le rôle d’un homme hétérosexuel dans le couple, en relationnant avec une femme et en ayant une vie de famille traditionnelle.

Toutefois, les muxes vestidas, habillés comme des femmes, ne peuvent pas être en couple ensemble. « Contrairement aux muxes, les lesbiennes sont considérées comme déviantes, éléments « non naturels » ; elles n’ont pas la même visibilité ni le même statut social que les muxes », précise Marinella Miano Borruso.
En bref, il n’y a pas une façon unique d’être muxe.
D’autre part, la communauté muxe est aujourd’hui reliée aux communautés queer, notamment parce qu’iels ont en commun la remise en question des normes genrées et hétérosexuelles.
Le pouvoir social d’être muxe
Les femmes étant les seules à avoir de l’influence et à faire perdurer l’héritage, il n’est pas rare que le dernier garçon de la fratrie soit incité à devenir muxe. Il s’agit d’une véritable initiation de la part des femmes pour que les petits garçons apprennent à « devenir femme », soit à profiter d’une place sociale semblable à celle des femmes.
« Beaucoup de mères veulent absolument un·e muxe, et donc elles poussent leur fils à devenir muxe », raconte Félina Santiago, interrogée dans le reportage de Duo Explor.
Quand la figure matriarcale de la famille, la grand-mère ou la mère, meurt, ce sont les muxes qui héritent de l’autorité morale et unifient la famille en cas d’absence de figure féminine.
« Pour une mère zapotèque, avoir un enfant muxe représente une protection et un support moral, surtout quand elle reste seule et vieille, ou abandonnée par son mari », écrit Marinella Miano Borruso.

Les garçons homosexuels sont également incités à explorer et embrasser leur féminité, voire à devenir muxe pour occuper le rôle social puissant qu’offre ce statut. Dans cette société où ce sont les femmes qui dirigent, les muxes sont admis·es dans certains rituels et activités normalement réservés à la gent féminine.
Les muxes réalisent des tâches associées au rôle féminin et à son prestige. Prendre soin des enfants et des personnes âgées, cuisiner, décorer, broder sont autant d’activités interdites aux hommes que les muxes peuvent entreprendre. Les muxes peuvent également travailler dans des domaines normalement réservés aux femmes.
D’un point de vue ethnique, les muxes ont un rôle primordial dans la reproduction et l’affirmation de l’identité zapothèque. Ce sont les muxes qui conçoivent « les habits traditionnels des femmes, leurs parures, les décorations des fêtes sacrées et les chars allégoriques qui défilent lors des fêtes les plus importantes », comme le précise l’anthropologue.
Les Muxes, une population discriminée ?
Aujourd’hui, certain·es personnes reprochent aux muxes d’empiéter sur le rôle que tient la femme dans la société zapotèque. La féminisation d’une grande partie des muxes, à travers le port de vêtements de plus en plus féminins, sont perçus comme « une forme d’auto-affirmation subversive visant à choquer le cadre sacré des traditions » (Gauvin, 2011). Des femmes dénoncent le fait que des muxes féminin·es portent des vêtements traditionnels en public.
Les générations plus âgées de muxes sont également réticentes quand elles voient les jeunes muxes affirmer leur féminité de façon plus visible qu’elles n’osaient le faire auparavant (Gauvin, 2011).
Les autorités locales ne permettent pas toujours un accès facile aux changements de papiers d’identités, comme le raconte Binizia dans les colonnes du Point : « ils ne donnent pas à beaucoup d’entre nous la possibilité de changer de nom ».
Parfois, la violence a lieu au sein même des familles : « au sein de la famille, il serait plutôt fréquent de voir les pères et les frères aînés manifester de la honte et un profond désaccord face à l’efféminement du jeune muxe. Ces derniers tenteraient alors de le « corriger », parfois de manière violente, surtout si la personne muxe choisit, comme il est de plus en plus fréquent, d’affirmer son genre féminin publiquement » (Gauvin, 2011).
Dans un article publié sur le site internet Vice, La Toya raconte que Juchitán n’est plus aussi accueillante qu’autrefois : « Même si l’on est plus ou moins libre, cette ville, c’est pas le paradis. Il y a encore du chemin à faire. Il faut qu’on arrête de nous voir comme des attractions touristiques ».
Pour autant, les muxes sont respecté·es à Juchitàn. « Je suis muxe et je suis bien intégrée. Ici, je suis respectée. Et j’en suis fière », raconte Mística, également interrogée par Luis Cobelo pour Vice.
Autre point : si les muxes se déplacent dans d’autres régions, iels ne sont plus aussi bien accepté·es. Certaines populations ont adopté des attitudes très hétéronormatives et machistes à la suite de la colonisation. Le Mexique est également considéré comme l’un des pays les plus dangereux pour les personnes transgenres et les muxes sont également touché·es par cette violence.
Les muxes célèbres
Estrella Vasquez

C’est la première muxe à faire la couverture du magazine Vogue en 2019. Quatre ans plus tard, elle est la première muxe à être nominée aux prestigieux prix Ariel, l’équivalent des César ou des Oscars pour le cinéma mexicain.
Elle a été nommée dans la catégorie du meilleur costume pour son travail sur le film Finlandia, où elle a mis en valeur les tenues traditionnelles de la région de l’isthme de Tehuantepec.
Estrella Vásquez milite également pour sensibiliser le public aux défis et aux discriminations que rencontrent encore les muxes au Mexique, tout en célébrant leur culture et leur identité.
Felina Santiago Valdivieso

Elle est une figure de la communauté de Juchitán, connue pour son rôle d’activiste dans la lutte contre le VIH et les discriminations. Elle est souvent citée comme une voix importante de la communauté muxe. Son témoignage est d’ailleurs présent dans le reportage de Duoexplor.
Lukas Avendaño

Né en 1977 à Oaxaca, Lukas est un artiste performeur, chorégraphe, danseur et anthropologue mexicain. Il est reconnu comme une figure majeure de la communauté muxe.
Son œuvre artistique se concentre sur l’exploration de l’identité muxe, des rôles de genre, et des tensions entre la culture zapotèque, l’identité queer et les influences occidentales.
Il a notamment présenté son travail dans le monde entier, comme sa pièce Réquiem para un Alcaraván qui a été jouée au Musée du Quai Branly à Paris.